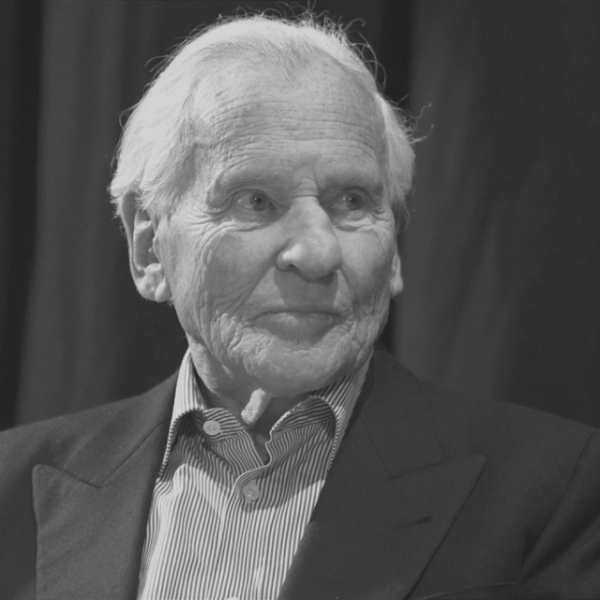Un amour pour rien, de Jean d’Ormesson, raconte une banale histoire d’amour – mais qui mérite d’être lu à la lumière des théories girardiennes.
La théorie girardienne
René Girard a une pensée de système. Il s’efforce de créer des grilles uniques qui permettent d’analyser l’ensemble des rapports humains. Pour cet auteur, les rapports interpersonnels ont tous pour base unique le mécanisme du désir mimétique. Dans Le Bouc émissaire, Girard explique ainsi ce mécanisme :
Je veux ce que l’autre désire ; l’autre souhaite sûrement ce que je possède. Tout désir n’est que le désir d’un autre pris pour modèle.
En d’autres termes, il n’existe pas de désir spontané. On ne désire que ce que l’autre possède. Cet autre, Girard le nomme médiateur. Deux systèmes sont alors à distinguer : la médiation externe et la médiation interne. La médiation externe correspond au cas où le médiateur et le désirant sont trop éloignés, socialement, physiquement, historiquement ou intellectuellement, pour pouvoir être en contact. C’est le cas, par exemple, de Raskolnikov avec Napoléon dans Crime et châtiment. La médiation interne correspond au cas, beaucoup plus fréquent, où le désirant et le médiateur évoluent dans la même sphère. C’est le cas typique des triangles amoureux.
Dans le cas de médiation interne, puisque le désirant désire par l’intermédiaire d’un médiateur qui est pour ainsi dire face à lui, alors l’objet désiré se retrouve pris dans une concurrence entre deux personnes. Cette concurrence engendre une violence : le médiateur devient un rival.
Dans Mensonge romantique et vérité romanesque, Girard montre comment les écrivains réalistes ont toujours tenu en échec, consciemment ou non, le mythe romantique du désir spontané (le « coup de foudre »).
Application n° 1
L’histoire d’Un amour pour rien est la suivante. Le narrateur, Philippe, se rend en vacances à Rome avec Françoise, une amie qui est aussi une amante occasionnelle. Dès les premières pages, le désir mimétique se manifeste. Françoise, qui se trouve déjà à Rome, attend Philippe à la gare. Quand ce dernier arrive, elle est accompagnée de trois jeunes Italiens. Le narrateur, tout de suite obsédé par ces concurrents, se demande lequel des trois la désire :
Pendant le trajet de la gare à l’Albergo al Graspo de Ua, je m’amusai à deviner si l’un ou l’autre des trois garçons italiens qui nous accompagnaient était l’amant de Françoise. À la Piazza Venezia, Roberto eut un mot hardi ; à la piaza Colonna, Riccardo fit un mouvement suspect. Je regardai Françoise en souriant d’un air sot qui se voulait averti.
Le narrateur se veut rassuré, il pense encore être le médiateur. Mais très vite, les rapports vont s’inverser. Dans les cas de médiation interne, le désirant et le médiateur entrent très vite en conflit et se placent tous les deux en concurrence face à l’objet désiré. Ils deviennent tous les deux à la fois désirant et médiateur. Ils s’indifférencient. De cette indifférenciation naît la rivalité mimétique.
Suite à cette première retrouvaille, pendant que Philippe s’acharne toujours à vouloir trouver lequel des trois hommes est l’amant de Françoise, son désir envers cette dernière augmente fortement – c’est qu’il subit une triple médiation. Son amour devient presque intolérable. En même temps, il ne cesse d’interroger Françoise…
– Françoise, dis-je à mi-voix, ces garçons que nous avons vus hier …
– Oui ? Dit Françoise
Elle s’était soulevée un peu, écartée de moi pour regarder mieux. Mon Dieu ! Comme elle devait s’amuser ! Elle savait déjà ce qui me tourmentait. Sa vie, c’était ça : son plaisir à elle et les questions des autres. La voiture roulait toujours. Le cocher ne nous parlait plus. Il contemplait tout seul, un peu amer, la Rome des Papes et des Césars.
– Lequel est ton amant ?
Merveilleuse Françoise ! Elle se mit à rire.
On le voit, la situation commence à virer de bord. Au début, Philippe est rassuré. Il contemple avec satisfaction les Italiens se battre pour Françoise. Il pense alors être le médiateur. En réalité, il est lui-même désirant par l’intermédiaire des Italiens. Le désir mimétique se met en branle, l’amour du narrateur pour Françoise augmente à proportion de sa haine pour les Romains.
Quelques pages plus loin, Philippe a rendez-vous avec Françoise dans un restaurant. Son amie a souhaité que ses compagnons italiens se joignent à leur déjeuner. Cette phrase échappe alors au narrateur :
Je m’assis au pied de la fontaine, les jaillissements de l’eau me pénétraient de fraîcheur. « Pourvu qu’ils ne viennent pas », dis-je à Françoise. Je terminais à peine ma phrase qu’ils débarquaient d’une voiture verte.
On comprend mieux, désormais, l’aversion de Philippe pour les trois garçons, alors pourtant que ces derniers l’amusent au début du roman. C’est que leur statut a changé : ils sont passés de désirants à médiateurs. De fait, ils sont devenus les rivaux du narrateur. Celui-ci, qui les traite en ennemis, n’a plus que du mépris à leur accorder.
La suite du récit est assez banale. À la fin du déjeuner, le narrateur rencontre par hasard Béatrice, une vague connaissance assise à la même terrasse. Ils engagent la discussion et finissent par passer la soirée ensemble. Béatrice tombe sous le charme de Philippe. L’histoire commence à tourner en rond, lorsque se produit un deuxième événement que seul peut expliquer le mécanisme du désir mimétique.
Application n° 2
Philippe, à court d’argent, se rend chez son oncle Georges pour lui emprunter de l’argent. Là encore, la mécanique girardienne s’enclenche inexorablement en trois temps. D’abord, le lecteur comprend que l’oncle Georges est pour Philippe un médiateur :
L’oncle Georges ne savait à peu près rien, mais il était amusant. Il aimait les voyages et les femmes. Il s’habillait très bien – trop bien. Il se droguait un peu. Il s’était bien débrouillé. Je crois qu’il s’était fait entretenir, quand il était plus jeune, par une Américaine assez fameuse qui le traînait de bar en bar et de palace en boîte de nuit. Ça m’épatait.
Georges épate Philippe, il est pour lui un modèle. Mais la situation va très vite s’inverser, car le narrateur s’aperçoit subitement – un peu aidé, il est vrai – de la présence de la maîtresse de son oncle. Puisque son oncle est médiateur et qu’il la désire, Philippe se met à son tour à la désirer, par mimétisme. Cela tombe bien : la maîtresse de son oncle lui fait du pied.
Ah ! C’était flatteur, ça. Une femme qui vous fait du pied et dont on ne sait même pas le nom.
Enfin, la rivalité se met en place. Philippe et Georges ont désormais le même objet de désir, ils sont en concurrence. Le narrateur n’a dès lors plus du tout le même regard sur son oncle que celui porté quelques lignes auparavant : à présent, il le méprise, il le traite en rival.
Oncle Georges, tout à coup, me paraissait un peu ridicule et me faisait un peu de peine. Il y a des moments comme ça où on se sent le maître de tout.
Là encore, seul le mécanisme du désir mimétique peut expliquer le revirement soudain de Philippe concernant les qualités de son oncle. Philippe, bêtement, regarde ce que son oncle désire, puis désire le même objet, entrant ainsi en concurrence avec celui-ci.
Par la suite, Philippe retrouve Béatrice et lui raconte sa discussion avec son oncle. Béatrice le questionne sur la maîtresse de Georges. Et voici la réflexion que se fait le narrateur :
Comment eût-elle pu être jalouse de cette vieille maîtresse de mon oncle ? Et pourtant elle aurait dû l’être.
Elle aurait dû l’être, en effet. Quelques jours plus tard, Philippe finit par coucher avec la maîtresse de son oncle. La question de l’argent développée par le narrateur n’est qu’une excuse – il l’avoue d’ailleurs lui-même quelques lignes plus loin. La vérité est dans les faits. Philippe a vu son oncle désirer sa maîtresse, il l’a désirée à son tour. Ce n’est ni la première fois, ni la dernière fois qu’il est victime du désir mimétique.
Application n° 3
La suite du roman de Jean d’Ormesson est encore plus intéressante quand on l’analyse à travers la grille de René Girard. Sans cette grille, elle est d’ailleurs incompréhensible.
Philippe, grâce à l’argent de son oncle, visite l’Italie en compagnie de Béatrice. Celle-ci déborde de passion pour son amant, mais lui ne l’aime déjà plus. Son désir est assouvi. Ils rentrent à Paris, continuent à se fréquenter. Un soir, Philippe, définitivement lassé de Béatrice, rompt avec elle de façon brutale. Il recommence alors à flirter avec Françoise. Un matin, cette dernière lui annonce que Béatrice couche avec Riccardo (l’un des trois Italiens du début). Le narrateur est sidéré. La mécanique du désir mimétique s’enclenche de manière particulièrement violente à ce stade du récit. Le narrateur, qui confond amour spontanée et désir mimétique, est dans l’incompréhension la plus totale. Alors que c’est lui-même qui a méchamment rompu avec Béatrice, il devient fou d’amour en apprenant que celle-ci a un nouvel amant. Il se persuade, quant à lui, d’avoir toujours aimé Béatrice.
Je savais déjà que si ce que Françoise venait de m’apprendre était vrai – comment ne l’avais-je pas prévu ? Mais si, je l’avais prévu ! Pourquoi ne l’avais-je pas évité ? – tout était perdu pour toujours. J’appris que j’aimais Béatrice en apprenant que j’allais souffrir. Et cet amour et cette souffrance qui me frappaient en même temps, il me semble aujourd’hui que je compris aussitôt, sans oser me l’avouer, qu’ils n’auraient pas de fin.
Philippe est complètement déboussolé. Il a quitté Béatrice, et quand il apprend qu’elle a un amant, il l’aime passionnément. Pourquoi cela ? Tout s’explique avec le désir mimétique. Mais Philippe ne le comprend pas encore.
Mais une question préalable, que j’avais à adresser moins à Françoise qu’à moi, se pose ici avec une éclatante évidence. Je ne la formule moi-même qu’avec une gêne très grande. Mais elle s’impose d’elle-même : pourquoi souffrais-je, puisque j’avais délibérément refusé l’amour que m’offrait Béatrice ?
Le narrateur, bien sûr, ne répond jamais à cette question car elle suppose qu’il se débarrasse du mot amour pour se concentrer sur celui de désir. Ce qui revient à annihiler son récit, qui ne tourne qu’autour de l’amour.
Dans la suite du récit, Philippe croise par hasard Béatrice dans la rue et lui avoue son amour pour elle. Hélas, les sentiments de Béatrice ont évolué et elle doit lui avouer qu’elle ne ressent, de son côté, plus rien pour lui. Le narrateur est fou de douleur. Médiation oblige, il ne parle alors plus de Béatrice que par le biais de Riccardo :
Et je faisais l’amour avec Françoise ; et je pensais à Béatrice nue dans les bras de Riccardo. […] En dehors du petit groupe de Françoise, de Béatrice, de Riccardo dont je n’osais plus prononcer le nom en moi-même et des quelques autres qui gravitaient autour de nous, j’avais un certain nombre d’amis qui m’avaient fait une réputation de cynisme, de légèreté et d’indifférence dont je m’accommodais fort bien. […] Riccardo avait une Fiat d’une couleur très vive et assez particulière. Lorsque je trouvais la voiture à la porte de la maison de Béatrice, c’étaient des tortures banales mais que je ne souhaite à personne, et l’angoisse m’empêchait de vivre. […] Plusieurs fois je revis Béatrice. Par une de ces permanentes contradictions de l’amour, je lui en voulais presque de consentir à ces rencontres que je la suppliais de m’accorder. Elle le faisait par pitié, je le sentais, et je sortais de ces entrevues blessé et désespéré. Un des motifs, très bas, qui me poussait à les solliciter était un aveu qu’elle m’avait fait : elle venait me voir en cachette de Riccardo.
Seul le désir mimétique, à ce moment du livre, permet d’expliquer le comportement du narrateur – celui d’aimer passionnément la femme qu’il a rejetée, après avoir appris qu’elle a une liaison avec l’Italien. Tant qu’il possédait Béatrice, il ne la désirait plus. Maintenant qu’il la voit désirée, il brûle à son tour, par imitation, de désir pour elle.
Coup de tonnerre. Un soir, Béatrice, enceinte, rejetée par son amant, vient trouver Philippe dans sa chambre. Les deux jeunes gens se prennent dans les bras et pleurent abondamment. Philippe réitère sa déclaration d’amour à Béatrice. Béatrice réitère son refus de l’aimer. Nous sommes alors au point d’orgue de l’histoire de Jean d’Ormesson. Philippe, à moitié saoul, récite à Béatrice quelques vers tirés d’un poème de Heine. Ils décident ensemble de le traduire en français :
Le petit poème signifiait à peu près ceci que Béatrice apprit par cœur :
Un jeune homme aime une jeune fille
Qui en a choisi un autre.
Cet autre en aime une autre
Et il s’en va l’épouser.
La jeune fille épouse de rage
Le premier homme venu
Qui lui passe entre les bras.
Le jeune homme en est malade.
C’est une vieille histoire
Mais elle reste toujours neuve.
Et celui qui la revit,
Son cœur se brise en deux.
Le lecteur pourrait être passablement surpris de l’activité de traduction effectuée fébrilement par les deux jeunes gens dans une situation aussi tendue, qui semble tomber comme un cheveu sur la soupe. Pourtant, ce poème de Heine, qui ne peut se comprendre qu’au regard de la théorie girardienne, est précisément cité parce qu’il illustre à merveille le mécanisme dont il est question depuis la première ligne du récit. Si l’amour était spontané, la jeune fille et le jeune homme auraient chacun leur histoire, ils vivraient tous les deux heureux et sans problème. Au contraire, ils deviennent chacun médiateur de l’autre. Pourquoi le jeune homme aime-t-il la jeune fille ? Parce qu’elle en a choisi un autre. Pourquoi la jeune fille aime-t-elle ce tiers ? Parce qu’il en aime une autre. Rien n’est jamais dual dans ce texte, tout se fait toujours par l’intermédiaire d’un autre. Toute leur histoire, tragique, tourne autour du fait que le jeune homme désire ce que la jeune fille désire et que la jeune fille désire ce que l’autre homme désire. Tous les protagonistes deviennent à la fois médiateurs et désirants, ils s’indifférencient, la rivalité se met en branle, les ressorts de la violence se détendent, et les cœurs sont brisés. Ce n’est pas pour rien que ce poème est cité à ce point précis du roman de Jean d’Ormesson. Il raconte exactement la même chose que l’histoire de Philippe : la théorie du désir mimétique.
Lectures conseillées
- Mensonge romantique et Vérité romanesque, R. Girard, 1961.
- Un amour pour rien, J. d’Ormesson, 1960.